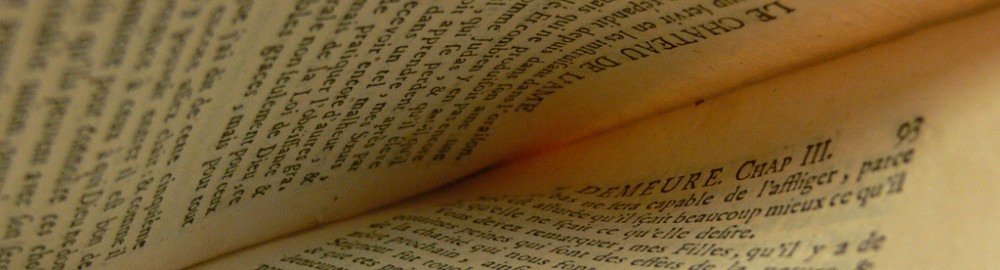La traduction de la poésie : outil de critique littéraire
Colloque international
les 12 et 13 septembre 2008, Palais des Congrès, Perros-Guirec (Côtes d’Armor)
Colloque organisé par la SEPTET et l’AELPL
Comité organisateur :
- Jean-Pierre Attal
- Florence Lautel-Ribstein
Comité scientifique :
- Comité scientifique de SEPTET
La traduction de la littérature, de la poésie en particulier, est un des moyens d’analyse textuelle les plus pertinents et les plus productifs. En développant une conscience critique plus aiguë chez le traducteur, la traduction de la poésie permet une réflexion plus approfondie sur la nature même du langage ainsi que sur les diverses strates de la communication où se trouvent impliqués à la fois le traducteur au cours du processus de recréation et le lecteur lors de la réception du texte traduit. D’autre part, elle stimule le développement du jugement qualitatif des œuvres poétiques traduites.
Jusque vers la fin du XVIIIe siècle, la poésie était définie surtout en tant que genre ou catégorie générique (poésie épique, lyrique, satirique, didactique). Sur le plan théorique, les traités comme l’Art poétique de Boileau par exemple, codifiaient et prescrivaient des règles s’apparentant davantage à des lois morales qui rappelaient celles d’Horace à qui l’on doit une interprétation normative des règles de la Poétique d’Aristote. Les théories de la traduction de cette époque étaient ancrées dans cette tendance codificatrice et ethnocentrique. Le succès des « belles infidèles » en Europe en témoigne assez bien. Mais la remise en cause, sous l’influence d’écrivains comme Diderot ou Rousseau, de la notion de genre, les débuts de la perception des autres-langues culture comme des formes d’expression égales à la langue-source ainsi que l’assimilation croissante de la notion de poéticité à la poésie ont fait peu à peu évoluer autant la critique littéraire et la poétique de la poésie que les pratiques et théories de la traduction.
Trois pistes de réflexion pourraient être envisagées :
- Approches descriptives et interprétatives de la critique littéraire et théories de la traduction de la poésie : perspective diachronique
La pratique de la traduction de la poésie a induit et modifié, à des époques et dans des cultures diverses, les approches interprétatives de la littérature. D’autre part, le développement de la théorisation du traduire, depuis le XIXe siècle en particulier, viendra, à son tour nourrir la réflexion critique : depuis l’idée d’une salutaire multiplication des traductions d’un même texte émise par Humboldt, en passant par le respect de l’étranger dans le texte souligné par Schlegel, jusqu’à la mise en avant par Matthew Arnold de la nécessité de l’union de la critique et de la traduction, les théories de la traduction n’ont pas cessé de démontrer que la réflexion traductive appliquée à la poésie, lieu d’une intensification de la signification, étaient le creuset de la réflexion sur le langage et donc un outil de critique littéraire : « Lorsque nous apprenons à parler, nous apprenons à traduire…le langage lui-même est déjà une traduction, en premier lieu du monde non-verbal » (Octavio Paz). - La traduction de la poésie, l’exploration de l’expérience du poétique et ses implications pour la critique littéraire
La pratique de la traduction de la poésie à l’époque contemporaine doit répondre à des critères de plus en plus exigeants. Cette exigence a pour conséquence une exploitation accrue des possibilités expressives de la langue d’arrivée dans l’acte de traduction, exploitation qui va induire une exploration des méthodes de recherche dans l’art de l’interprétation des textes poétiques.
La réflexion pourrait s’engager ici dans plusieurs directions :
– Une première envisagerait la traduction comme un prolongement de l’œuvre poétique parce qu’elle fait de son approche critique une appréhension de l’événement qui se passe à l’intérieur de l’œuvre. Elle aide à saisir la nature de l’expérience poétique.
– Une autre s’interrogerait sur ce que permet la traduction de la poésie : une (re)formulation des notions et des concepts utiles à l’analyse des textes littéraires dans leur ensemble.
– Une autre enfin ferait état des méthodologies dont usent les traducteurs et qui sont susceptibles de devenir des modèles par lesquels les critiques vont modifier leurs propres méthodologies. - Pour un nouveau recensement des œuvres poétiques traduites
Quels peuvent être aujourd’hui les paramètres qui vont permettre un recensement qualitatif des traductions de la poésie ? Comment et par qui ces paramètres peuvent-ils être élaborés ? Qui est le plus à même de jouer le rôle de critique en la matière, le poète, le philosophe ou le théoricien de la traduction ?
PROGRAMME :
Vendredi 12 septembre
9 h 00 : Ouverture du colloque par Yvon BONNOT, Maire de Perros-Guirec
9 h15 : Introduction au colloque par Jean-Pierre ATTAL, Président de l’AELPL et par Florence LAUTEL-RIBSTEIN, Présidente de SEPTET.
9 h 30 : Discours inaugural par le poète, essayiste et écrivain Kenneth WHITE.
Table ronde 1 : Les traductions poétiques : un événement critique au XXIe siècle. Présidence : Antonio LAVIERI (Bologne, Italie – ISIT, Paris).
10 h 00 : Florence LAUTEL-RIBSTEIN (Présidente SEPTET), De l’empire de la poésie à l’empire de la traductologie : la poéticité comme outil de critique littéraire.
10 h 20 : Pause.
10 h 30 : Lecture de l’intervention d’Henri MESCHONNIC.
11 h 00 : Antonio LAVIERI (Bologne, Italie – ISIT, Paris), Valéry-Benjamin : notes pour une anthropologie symbolique des pratiques traduisantes.
11 h 30 : Olivier KACHLER (Amiens, France), Les lieux critiques du poème en traduction.
12 h 00 : Débat.
12 h 30-14 h 00 : Déjeuner.
Table ronde 2 : Exploration de concepts critiques. Présidence : Florence LAUTEL-RIBSTEIN (Présidente SEPTET).
14 h 00 : Geneviève COHEN-CHEMINET (Paris IV), L’épreuve de la traduction : une expérience de la création poétique.
14 h 30 : Maryvonne BOISSEAU (Paris III), Traduire Saint-John Perse : raison poétique et intuition critique.
15 h 00 : Claire DAVISON-PEGON (Aix-Marseille, France), Première personne et singulière ? La poésie traduite par Antonin Artaud.
16 h 00 : Débat.
16 h 30 : Pause.
Table ronde 3 : Positions traductologiques revisitées. Présidence : Camille FORT (Amiens, France).
16 h 45 : Françoise WUILMART (Bruxelles, Belgique), Le poème à traduire : pré-texte ou prétexte.
17 h 15 : Madeleine STRATFORD (Québec, Canada), Ut pictura musicaque poesis: vers une protypologie ternaire du poème et de ses traductions.
17 h 45 : Taffy MARTIN (Poitiers, France), Traduire la poésie ou le possible imaginaire.
18 h 15 : Sara AMADORI (Bologne, Italie), Les traductions de Shakespeare par Yves Bonnefoy : un exemple de critique par la traduction.
18 h 45 : Débat.
Samedi 13 septembre
Table ronde 4 : Approches contrastives. Présidence : Jean-Pierre ATTAL (Président AELPL).
9 h 00 : Monique ALAIN-CASTRILLO (ITEM, CNRS, Paris), Le cas des langues sans cas : la traduction à la deuxième puissance de la poésie hermétique.
9 h 30 : Jean BALCOU (Brest, France), La traduction de la poésie avec Armand Robin (1912-1961) : physique, outre-physique, métaphysique.
10 h 00 : Jean-Pierre ATTAL (Président AELPL), Antoine Berman et la critique de traduction.
10 h 30 : Débat et pause.
Présidence : David ELDER (Perth, Australie)
11 h 00 : Jacqueline COURIER-BRIERE (ITEM, CNRS, Paris), Re-création et interprétations. La poésie de Paul Valéry en arabe : difficultés, problèmes et réussites.
11 h 30 : David ELDER (Perth, Australie), Traduction, exégèse et génétique littéraire : étude de quelques cas limites en ouverture et en fermeture dans la poésie de Paul Valéry.
12 h 00 : Débat.
12 h 30 -14 h 30 : Déjeuner.
Table ronde 5 : Langue chinoise en traduction de la poésie et nouvelles approches critiques. Présidence : Véronique ALEXANDRE-JOURNEAU (Réseau Asie – IMASIE (CNRS/FMSH) ).
14 h 30 : Siyan JIN (Artois, France), La traduction du symbolisme français et la nouvelle poétique chinoise.
15 h 00 : Laurence WONG (Université chinoise de Hong Kong), Translation as Critical Fine-Tuning : With Reference to Shakespeare’s Hamlet.
15 h 30 : Véronique ALEXANDRE-JOURNEAU (Réseau Asie – IMASIE (CNRS/FMSH) ), Les trois forces externes à l’œuvre en traduction poétique et les paramètres d’appréciation du poète.
16 h 00 : Débat et pause.
16 h 30 : Benedetta ZACCARELLO (ITEM, CNRS, Paris – Florence), Amelia Rosselli entre trois langues : poésie, identité, traduction de soi.
17 h 00 : Christine EVAIN (Nantes, France), Problématiques de repérage et de traduction des métaphores créatives lakoffiennes dans la poésie de Margaret Atwood.
17 h 30 : Caroline BERTONECHE (Reims, France), La « translation »-transformation des poèmes comme relecture critique : palimpsestes et « mécompréhension » chez Keats.
18 h 00 : Débat.
18 h 30 : Synthèse par Florence LAUTEL-RIBSTEIN.