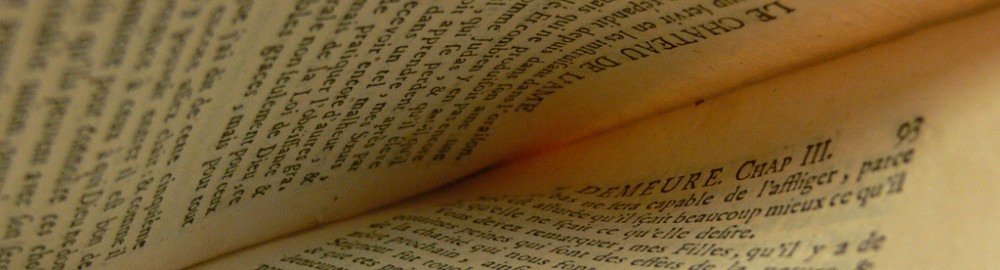Rhétorique et Traduction
Université d’Orléans,
Jeudi 26 et vendredi 27 janvier 2012
5, rue du Carbonne (Bâtiment IRD)
45000 Orléans
Organisé par SEPTET, Société d’Etudes des Pratiques et Théories en Traduction et LLL, Laboratoire Ligérien de Linguistique de l’université d’Orléans en collaboration avec l’HTLF, l’Histoire des traductions en langue française de Paris-Sorbonne
Comité organisateur :
- Pierre Cadiot (Université d’Orléans)
- Florence Lautel-Ribstein (Université d’Artois)
- Antonia Cristinoi (Université d’Orléans)
- Gabriel Bergounioux (Université d’Orléans)
COMITÉ SCIENTIFIQUE :
- Pierre Cadiot (Université d’Orléans)
- Antonia Cristinoi (Université d’Orléans)
- Annie Cointre (Université de Metz)
- Véronique Duché (Université de Melbourne)
- Camille Fort (Université de Picardie)
- Jean-René Ladmiral (Université de Paris Ouest-Nanterre et ISIT)
- Michèle Lorgnet (Université de Bologne)
- Jean-Yves Masson (Université de Paris-Sorbonne)
- François Nemo (Université d’Orléans)
- Yen-Mai Tran-Gervat (Université de Paris-Sorbonne Nouvelle)
Pour les Latins, le terme Traductio désignait une figure de rhétorique. On mesure ainsi la pertinence d’une rencontre portant sur les liens entre traduction et rhétorique. Aujourd’hui, la rhétorique, tout comme la traduction, rapproche des champs disciplinaires variés : linguistique, littérature, anthropologie culturelle, philosophie du langage, etc.
Les différents axes de travail suivants pourront être explorés :
1. La traduction à l’aune des conceptions de la rhétorique
La rhétorique peut-elle être encore aujourd’hui conçue comme un ajout, un supplément d’âme et de présentation, voire un masque (plutôt qu’un visage) ? Autrement dit, la rhétorique cessant progressivement de se confondre comme dans l’Antiquité gréco-romaine avec l’art de dire, mais aussi de penser, peut-elle être confondue avec un ensemble de procédés, qui sans être strictement ornementaux, l’engagent néanmoins dans le sens d’une esthétique seconde, comme c’est le cas chez un Fontanier par exemple ? Le traducteur doit-il alors considérer qu’un « contenu » invariant est ainsi masqué ? Par voie de conséquence, la rhétorique peut-elle se confondre avec un aspect de l’art du traducteur qui serait de faciliter (mais aussi éventuellement d’agrémenter) la lecture ? Les dimensions clairement « rhétoriques » du texte-source (par exemple les questions précisément dites « rhétoriques », liées à la seule gestation du texte) doivent-elles être gommées dans le travail du traducteur ?
La rhétorique du traducteur a-t-elle une dimension « critique » ? Est-elle censée véhiculer (aussi) le point de vue singulier du traducteur ? Quelle est la part de la rhétorique dans le fait qu’historiquement les traductions ont si souvent fait l’objet d’adaptations marquées par la censure, l’idéologie, la volonté pédagogique, etc ? Quels sont les liens avec l’argumentation ? Le texte, la « lettre », doivent-ils dans l’acte de traduire s’effacer derrière des intentions, représentationnelles, polémiques et autres ? La rhétorique est-elle une « technique » ou un art « tactique » ? Le traducteur doit-il être rusé ?
Doit-on à rebours s’attacher à relever, comme le fait Dumarsais, des liens étroits entre grammaire et rhétorique (nonobstant le trivium médiéval) ? La rhétorique, au contraire de l’idée commune, plonge-t-elle ses racines au coeur même de la langue ? Quelles seraient les conséquences d’une réponse positive pour la traduction ?
2. La traduction entre champs rhétorique, poétique et émotionnel
Quels sont les liens entre rhétorique en tant que visée d’action, proche de la pragmatique moderne et poétique en tant qu’imitation d’action (mimesis) ? La traduction doit-elle être conçue comme une action, rendre le texte-source toujours plus efficace, ou doit-elle déployer et explorer les sources de sa propre poéticité ?
La rhétorique est-elle délibérément « cibliste » ? Est-elle idiosyncrasique, un art différent dans chaque langue particulière… ou relève-t-elle au contraire de techniques tendanciellement universelles ?
La distinction entre rhétorique et poétique ne serait-elle pas une conséquence d’une vision réductrice de ce qu’était la rhétorique des origines, celle d’Aristote, comme semblent l’attester certaines des plus récentes traductions de son texte fondateur et qui montrent l’indissociabilité non seulement des propriétés sémantiques et esthétiques du langage, mais aussi de ses propriétés esthétiques et poétiques ?
On peut s’interroger sur le statut, instable et évolutif, de l’émotion lorsqu’elle est amenée à s’inscrire dans le champ rhétorique, que ce soit comme objet de représentation (rhétorique des passions) ou comme mode d’élocution visant à des effets perlocutoires. Qu’à l’occasion d’un événement émotionnel, on convoque le concept de thymie en sémiotique ou tout autre concept affine, comment cette « subconscience » où se déploient les instances affectivo-émotives est-elle saisie dans l’acte traductif ?
3. Rhétorique et traduction dans leurs dimensions philosophiques et sémiologiques
On pourra d’une part s’interroger sur les points suivants :
- La rhétorique ne serait-elle pas au fond de nature philosophique ? Peut-on y voir l’art même de former des concepts en les délivrant ?
- La rhétorique se confond-elle avec la pragmatique moderne (wittgensteinienne, austinienne, etc) ?
D’autre part, il conviendra de se poser la question :
- des liens que la rhétorique noue avec la sémiologie et/ou la sémantique discursive et textuelle. Comment la traduction doit-elle prendre en compte des effets comme l’idiomaticité, le cliché, le stéréotype, llemblème, les « métaphores conceptuelles », etc ? Les questions évidemment décisives de l’analogie, de la polysémie, de l’implicite, de l’inférence, comme mécanismes de production des textes sont-elles rhétoriques et relèvent-elles à ce titre d’un chapitre autonome de l’art du bien traduire ? …
- des liens entre rhétorique, traduction et phénoménologie : le « contenu » peut-il être distingué de son apparaître, de ses modalités de donation ? L’essence figurale du langage renvoie-t-elle à l’expérience immédiate, au « corps vécu » ? La traduction est sans arrêt confrontée à cette alternance de présentation (figurale, motivée, phénoménologique) et la gestation de contenus de représentation. Tout accès au réel est partiel, de l’ordre de l’esquisse, mais il s’impose avec la force du tout : ce que la tradition figure en termes – trop analytiques – de métaphore, métonymie, synecdoque, etc. renvoie à cette réalité en quelque sorte anthropologique, mais très différemment d’une langue à l’autre. Comment la traduction doit-elle affronter ce problème ?
PROGRAMME
Jeudi 26 janvier
Amphi IRD
8h45 : accueil
9h15 : allocutions des organisateurs : Gabriel Bergounioux (Université d’Orléans), Florence Lautel-Ribstein (Université d’Artois), Antonia Cristinoi et François Nemo (Université d’Orléans).
9h30 : conférence plénière – Pierre Cadiot (Université d’Orléans) : « La rhétorique et l’épreuve de la traduction »
Amphi IRD. Session Approches textuelles
Figures rhétoriques revisitées et rhétorique de quelques genres littéraires ancestraux
Présidence : Camille Fort (Université de Picardie-Jules Verne, France)
10h – 10h30 : Michèle Lorgnet (Université de Bologne, Italie) : « Quelques figures de rhétorique oubliées en traduction »
10h30 – 11h : Magdalena Nowotna (INALCO, Paris, France) : « Le Trans – port de la métaphore »
11h – 11h20 : pause
11h20 – 11h50 : Adriana Orlandi (Université de Modène, Italie) : « Le procédé de déformation abstractive en traduction : le cas des traductions italiennes des Frères Zemganno d’Edmond de Goncourt
11h50 – 12h20 : Sebastián García Barrera (Centre d’Études et de Recherche Editer/Interpréter, Université de Rouen, France) : « “Sermons mal propres à la matiere” : rhétorique et traduction des commentaires moralisateurs dans le premier livre de l’Amadis de Gaule (1540) »
12h30 – 14h30 : repas restaurant Agora
Traduire la rhétorique du conte, de la fable et de la chantefable
Présidence : Magdalena Nowotna (INALCO, Paris, France)
14h30 – 15h : Muguras Constantinescu (Université de Suceava, Roumanie) : « Des divers degrés de rhétorique sous la plume du traducteur de contes »
15h – 15h30 : Franck Barbin (Université Hanyang, Corée du Sud) : « Traduire l’art du conteur : une autre forme de rhétorique »
15h30 – 15h50 : pause
15h50 – 16h20 : Charlotte Shapira (Technion – IIT, Haifa, Israël) : « De la morphologie au stéréotype culturel : la traduction de la fable »
16h20 – 16h50 : Hilla Karas (Université de Tel-Avis, Israël) : « Une rhétorique d’excès et d’absurde à traduire : l’exemple d’une chantefable du XIIIe siècle »
Plénière :
17h15 – 19h : Anne-Marie Houdebine (Université de Paris Descartes-Sorbonne, France) : « Une mosaïque théorique et pratique de la traduction : Traduire, un film de Nurith Aviv » Projection du film
20h30 : cocktail et repas restaurant.
Salle 2. Session Approches philosophiques et linguistiques
Philosophie, sémantique et traduction
Présidence : Pierre Cadiot (Université d’Orléans, France)
10h – 10h30 : Estelle Jouilli (Université de Nanterre, France) : « L’allant de soi de la traduction »
10h30 – 11h : Ariane Kiatibian (Université Paris Sorbonne, France) : « Science et expérience de l’expression – Regards sur la traduction dans l’approche phénoménologique du langage de Merleau-Ponty »
11h – 11h20 : pause
11h20 – 11h50 : Laetitia Pille (Université d’Orléans, France) : « Textes anciens et évaluation de traductions : De l’objectivité dans la langue »
11h50 – 12h20 : Bruno Poncharal (Université Paris 7, France) : « Sens et traduction en philosophie du langage »
12h30 – 14h30 : repas restaurant Agora
Pragmatique, pragmatique intégrée et traduction
Présidence : François Nemo (Université d’Orléans, France)
14h30 – 15h : Bruno Ambroise (Université d’Amiens, France) : « Les effets pragmatiques sont-ils des effets rhétoriques ? Du statut de la théorie des actes de parole par rapport à la rhétorique »
15h – 15h30 : Pierre-Yves Raccah (CNRS, LLL Orléans, France) : « Point de [vue sur le sens] sans [point de vue] rhétorique et non pas [Point de vue] sur le sens sans [point de vue] rhétorique »
15h30 – 15h50 : pause
15h50 – 16h20 : Zsofia Varkonyi (Université de Limoges, France) : « Vers une identification des potentialités sémantico-rhétoriques de la langue dans la perspective de la traduction des textes et des discours »
16h20 – 16h50 : Ksénia Filatova (Université d’Orléans, France) : « Universaux anthropologiques face à la traduction: dans un triangle russe – basque – espagnol »
Plénière :
17h15 – 19h : Anne-Marie Houdebine (Université de Paris Descartes-Sorbonne, France) : « Une mosaïque théorique et pratique de la traduction : Traduire, un film de Nurith Aviv » Projection du film
20h30 : cocktail et repas restaurant
Vendredi 27 janvier
Amphi IRD
Rhétoriques spécifiques et prises de position traductives contemporaines
Présidence : Antonio Lavieri (Université de Palerme, Italie)
10h – 10h30 : Ruth De Oliveira (Université de Cape Town, Afrique du Sud) : « La note de traducteur : « Entre rhétorique manipulatrice et argumentation alexithymique »
10h30 – 11h : Georgiana Lungu Badea (Université Timisoara, Roumanie) : « Censure idéologique, censure auctoriale, autocensure de la voix du traducteur »
11h – 11h20 : pause
11h20 – 11h50 : Marie-France Delport (Université de Paris-Sorbonne) et Yordanka Levie (Laboratoire de langues et civilisations à tradition orale, CNRS) : « Propositions autour des Voyages de Mme B. Ou le traducteur « restaurateur » »
11h50 – 12h20 : Fadoua El Hezeti (Université de Casablanca, Maroc) : « A la recherche des belles infidèles. Approche traductologique de la question rhétorique dans la traduction d’un corpus littéraire arabe en espagnol et en français »
12h30 – 14h30 : repas restaurant Agora
Traduire les métaphores
Présidence : Gabriel Bergounioux (Université d’Orléans)
14h30 – 15h : Enrico Monti (Université de Bologne, Italie / ILLE, France) : « Traduire la métaphore littéraire : problématiques cognitives et stylistiques »
15h – 15h30 : Raluca-Nicoleta Balatchi (Université de Suceava, Roumanie) : « Subjectivité et conceptualisation métaphorique en traduction. Les « métaphores du moi » en français et en roumain »
15h30 – 15h50 : pause
15h50 – 16h20 : Yvon Keromnes (Université de Metz, France) : « Les métaphores et leur traduction dans la vie quotidienne »
16h20 – 16h50 : Anna Francesca Naccarato (Université de Calabre, Italie) : « Modulations métaphoriques et métonymiques dans les traductions italiennes de La Poétique de l’espace de Gaston Bachelard »
Salle 2
Linguistique et traduction
Présidence : Pierre-Yves Raccah (CNRS, LLL)
10h – 10h30 : Alberto Giordano Bramati (Université de Milan, Italie) : « La traduction des répétitions entre lexique, grammaire et stylistique. Le cas du français vers l’italien »
10h30 – 11h : Bassam Barrake (Université libanaise de Tripoli, Liban) : « Peut-on traduire le trope ? Considérations linguistiques, cognitives et culturelles »
11h – 11h20 : pause
11h20 – 11h50 : Loïc Depecker (Université Paris-Sorbonne nouvelle, France) : « Quelques concepts clés de la terminologie à l’usage de la traduction »
11h50 – 12h20 : Guilhermina Jorge (Université de Lisbonne, Portugal) : « La phraséologie créative en traduction : préserver ou effacer»
12h30 – 14h30 : repas restaurant Agora
14h30 – 15h : Ineke Wallaert (Université de Strasbourg, France) : « Shifting meaning in translation studies »